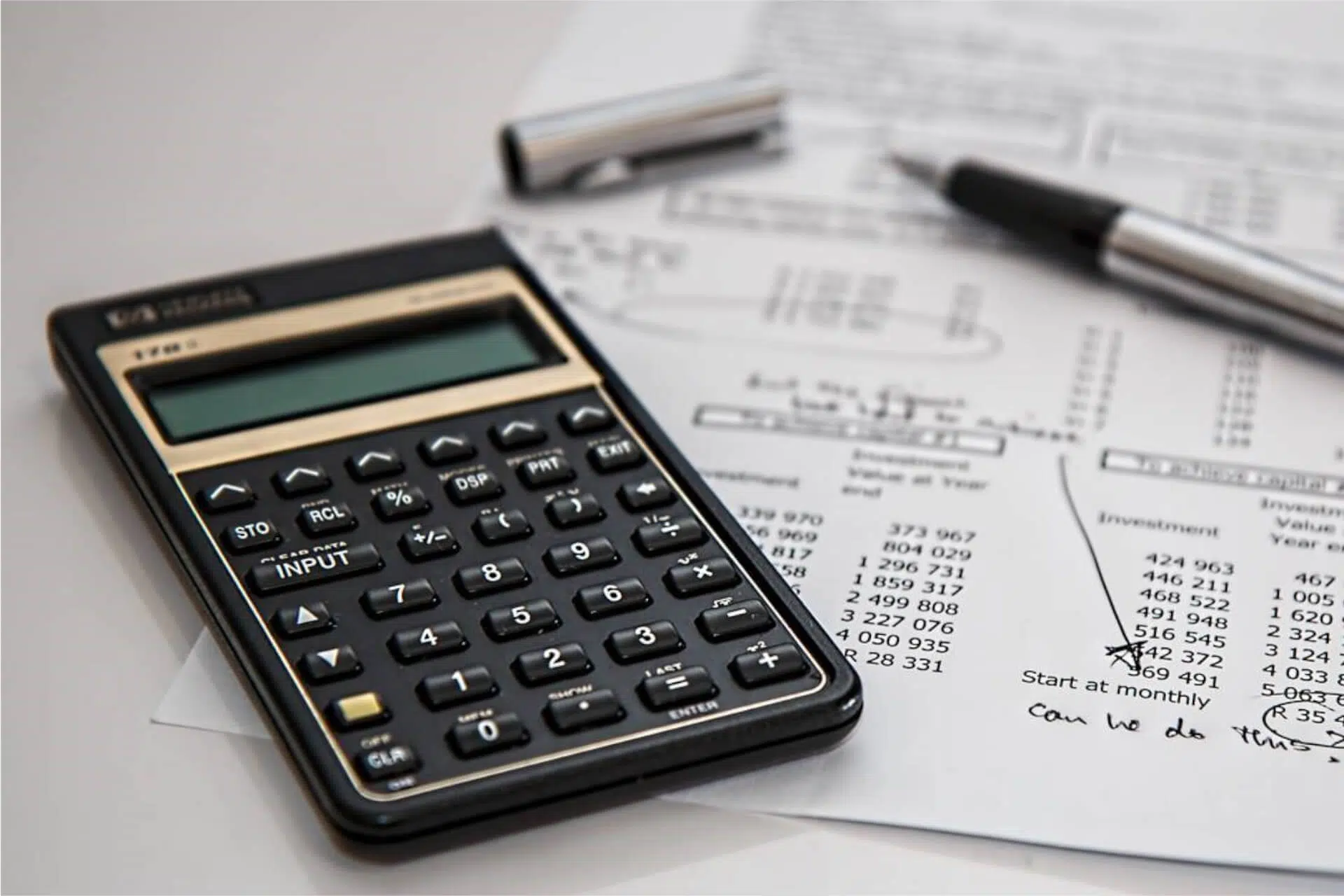Statistiquement, chaque année, près de 30 000 personnes s’engagent dans la formation d’accompagnant éducatif et social. Pourtant, ce chiffre, aussi massif soit-il, passe souvent sous les radars. Étrange paradoxe : ce métier irrigue nos sociétés sans faire de bruit. Le diplôme d’État d’Accompagnant Éducatif et Social (DEAES) cristallise bien davantage qu’un simple savoir-faire. Depuis 2016, il a fondu trois anciens diplômes en une seule certification, dotant tous les candidats, quelle que soit leur future spécialité, d’un socle commun solide.
Ouverte même sans le baccalauréat, la formation attire de nombreux profils, du jeune adulte aux personnes en transition professionnelle. Le parcours combine exigences du terrain, diversité des employeurs et choix entre cursus classique ou alternance. La route est tracée, mais le trajet reste exigeant, loin des regards de ceux qui n’y sont pas confrontés.
Le métier d’accompagnant éducatif et social : près des personnes vulnérables au quotidien
L’accompagnant éducatif et social (AES) occupe une place unique dans le paysage médico-social. Il agit là où d’autres hésitent : auprès des personnes fragilisées par l’âge, le handicap ou la maladie. Et son rôle ne se limite pas à des gestes techniques. Il accompagne chacun dans le fil des jours, chez lui ou en établissement, et veille aussi bien à l’hygiène au quotidien qu’à l’autonomie de la personne, à la qualité du lien social, à la possibilité de rester actrice de sa propre vie.
Aider à la toilette, accompagner aux repas… mais ce n’est qu’un début. L’AES tend la main, écoute, repère les signaux faibles, construit une relation de confiance sans jamais déposséder la personne de ses choix. Chaque intervention s’inscrit dans une logique de respect et d’équilibre.
Pour mieux cerner ce métier, voici les grandes dimensions de l’action de l’AES :
- Accompagnement dans la vie sociale : organisation de sorties, aide dans les démarches administratives, accès aux activités culturelles ou sportives.
- Soutien à l’autonomie dans les gestes quotidiens : déplacements, toilette, repas, échanges et interactions.
- Participation à des projets personnalisés, élaborés avec la personne accompagnée et son entourage.
Le quotidien d’un AES se vit rarement en solitaire : il travaille main dans la main avec d’autres intervenants du médico-social. Éducateurs spécialisés, infirmiers, assistants sociaux… les échanges sont constants, chacun apportant son regard et son expérience. L’observation, la signalisation de toute évolution, la vigilance, tout passe par la coopération. Le métier refuse la routine : on s’adapte, on ajuste, on réinvente, au rythme de chaque personne, quel que soit son âge ou sa situation.
Accéder au diplôme d’État AES : conditions et déroulement du parcours
Pour devenir AES, le passage par le DEAES est incontournable. Le niveau demandé à l’entrée équivaut simplement à une classe de troisième. Le recrutement repose sur un examen de dossier puis un entretien pour tester la motivation, la compréhension réelle du métier et la concordance avec le projet professionnel du candidat.
Sur 12 à 24 mois, ce parcours s’adresse à toutes les générations : jeunes en recherche de voie, adultes en quête de sens ou de reconversion. Trois grandes spécialités structurent l’ensemble du cursus :
- Accompagnement à domicile
- Accompagnement en structure collective
- Accompagnement vers l’éducation inclusive et la vie ordinaire
Des dispositifs permettent d’obtenir le diplôme partiellement ou totalement sur la base de l’expérience déjà acquise dans le secteur social. Il existe aussi la possibilité de signer un contrat d’apprentissage, à condition d’avoir trouvé un employeur dans le champ social ou médico-social.
L’évaluation ne se limite pas à la technique. Les épreuves, aussi bien écrites qu’orales ou pratiques, viennent mesurer l’aptitude réelle à adopter une posture professionnelle, à respecter chaque singularité, à accompagner avec discernement et éthique.
Zoom sur les formations : organisation, contenus, rythme
Le parcours dévoile trois grandes variantes : la formation en initial, la formation continue, et l’apprentissage. Lycéens, actifs, demandeurs d’emploi : chaque profil peut trouver un parcours approprie, ajusté à son tempo professionnel ou personnel.
L’enseignement s’articule autour de plusieurs modules, totalisant 840 heures de théorie. Les sujets abordés : connaissance fine des publics accompagnés, posture de l’aide, techniques d’appui au quotidien, dynamique de travail collectif. En parallèle, 840 heures de stages se déroulent dans différents types de structures : résidences pour personnes âgées, foyers spécialisés, maisons d’accueil, services à domicile. C’est lors de ces immersions que la compétence prend racine, sous l’œil des tuteurs professionnels et au contact direct des bénéficiaires.
Pour financer ou accéder à la formation, différents dispositifs sont mobilisables selon son statut professionnel ou ses expériences antérieures. Organismes publics ou privés, partout en France, proposent des sessions régulières et parfois des parcours en alternance, au fil des mois.
L’évaluation repose essentiellement sur le vécu du terrain : rédaction de rapports, examens à partir de cas pratiques, retour d’expériences. Le but ? S’assurer que chaque diplômé sort prêt à s’adapter sans faillir à des publics changeants et des contextes variés.
Débouchés et perspectives d’évolution : un métier qui bouge
Le DEAES permet d’accéder à une multitude de structures : établissements accueillant des personnes âgées, foyers de vie, instituts médico-éducatifs, services dédiés à l’accompagnement à domicile. Secteur associatif, fonction publique hospitalière, entreprises privées… Les recruteurs ne manquent pas, portés par le vieillissement de la population et l’émergence de nouvelles demandes sociales.
Enfants en situation de vulnérabilité, adultes confrontés à une perte d’autonomie, familles traversant des difficultés : partout, le diplômé intervient là où la proximité compte, dans une démarche centrée sur l’écoute, l’échange et la collaboration avec l’ensemble du réseau médico-social.
Ce métier ouvre la voie à plusieurs trajectoires professionnelles, à découvrir ici :
- Intégration rapide sur un poste stable au sein d’équipes pluridisciplinaires
- Mobilité d’une structure à une autre pour enrichir son expérience
- Montée en compétence possible grâce à la formation continue, pour se spécialiser ou envisager des passerelles
À mesure que l’expérience s’accumule, de véritables options de progression se présentent : interventions sociales de proximité, aide-soignant, éducateur spécialisé… Des passerelles existent pour ceux qui souhaitent changer de cap sans repartir de zéro. Le diplôme a trouvé sa reconnaissance chez les employeurs, ce qui fluidifie les transitions et encourage l’ascension au fil du temps. Dans ce secteur, évoluer n’a rien d’exceptionnel : c’est la réalité vécue de nombreux professionnels, motivés à la fois par le mouvement du secteur et par l’envie de tendre la main à ceux qui en ont le plus besoin.
Dans cette société qui redéfinit sans cesse la place de la vulnérabilité, choisir de devenir accompagnant éducatif et social, c’est décider d’agir là où grandir, simplement, redevient possible. Quant aux vocations ? Elles prennent forme sur le terrain, au croisement de rencontres singulières et de lendemains à façonner concrètement.