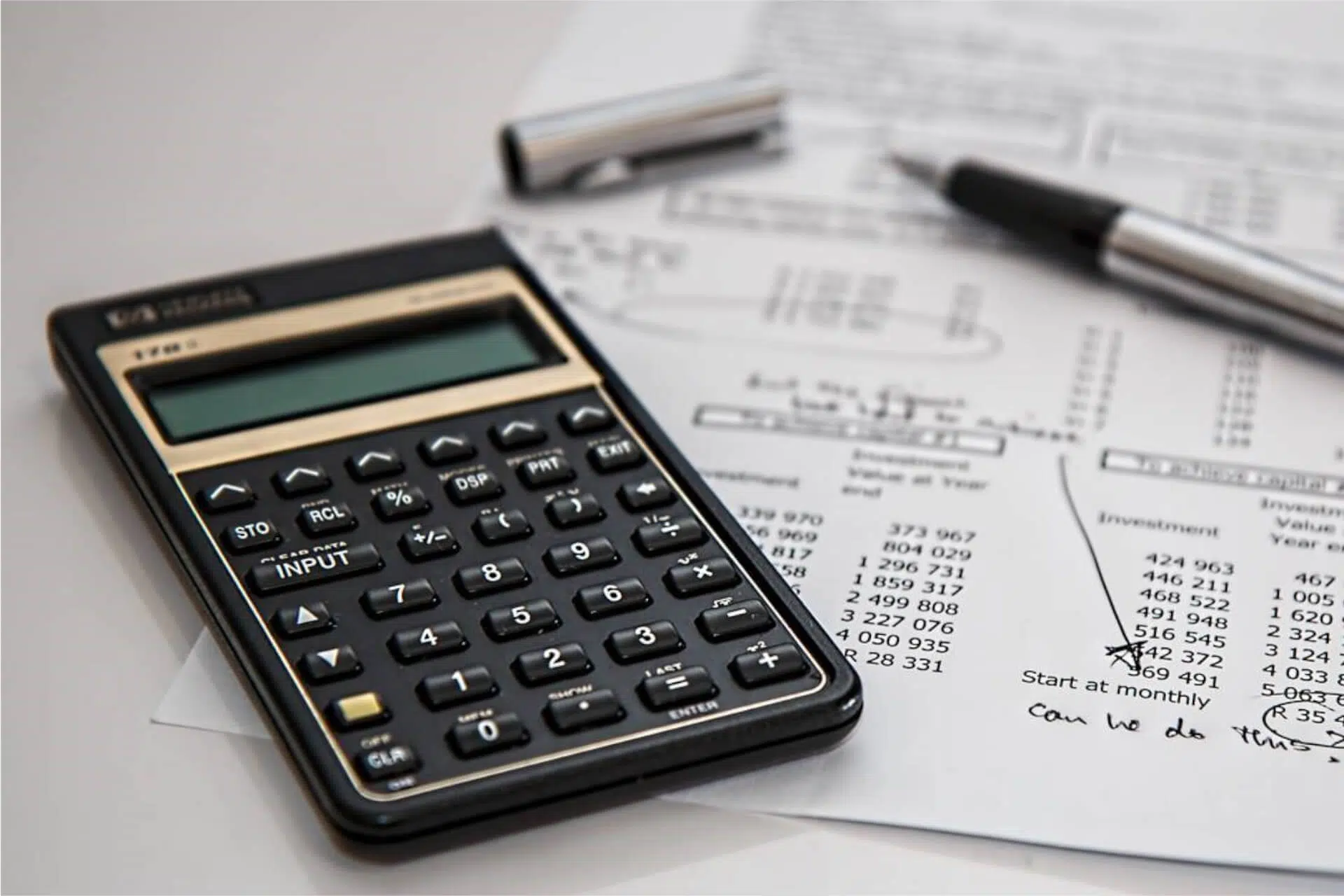Un chiffre sec, qui claque : plus de 30 % des vêtements cousus sur la planète sortent d’usines chinoises. Juste derrière, le Bangladesh et le Vietnam verrouillent leur place sur le podium. Des centaines de milliards de pièces expédiées chaque année, portées de mains en mains, de cargos en containers. Les dix géants du secteur se taillent la part du lion, pendant que les mastodontes de l’habillement dictent leur tempo à une industrie éclatée, mais redoutablement efficace. Au-delà des tableaux Excel, la filière textile repose sur une mécanique tentaculaire de sous-traitances et d’exportations, où chaque acteur joue sa partition dans une chaîne logistique sans frontières.
Où sont fabriqués la majorité des vêtements dans le monde ?
La Chine campe sur la première marche du podium de la production textile mondiale. Un tiers des vêtements sortent de ses lignes de confection chaque année, reléguant le reste du monde loin derrière. Cette domination ne se limite pas à l’assemblage : la Chine fournit aussi une grande partie des matières premières comme le coton ou le polyester, devenant incontournable pour les marques internationales. En 2024, le pays a écoulé près de 40 milliards de vêtements, bien plus que les États-Unis ou l’Europe, malgré leur appétit insatiable. L’Union européenne continue d’absorber à grande échelle les productions venues de Chine, sans oublier celles du Bangladesh, du Vietnam, de la Turquie et de l’Inde.
Le Bangladesh et le Vietnam se sont affirmés comme des piliers de l’export textile. Des millions de personnes y travaillent, dans un maillage d’ateliers et de sous-traitants, sous la pression constante des prix bas. L’Inde, quant à elle, s’impose par la taille de son marché intérieur et sa capacité à produire à grande échelle.
Voici comment se répartit le poids des principaux producteurs :
- Chine : à la fois premier fabricant et plus grand consommateur
- Bangladesh et Vietnam : champions de l’export vers l’Europe et l’Amérique du Nord
- Turquie et Inde : moteurs régionaux et fournisseurs clés dans la zone Asie-Moyen-Orient
La chaîne d’approvisionnement textile s’étend donc sur plusieurs continents. La concentration de la production dans quelques pays répond à l’appétit insatiable de la fast fashion, qui représente près de 60 % du marché mondial. Les grandes marques synchronisent cette organisation, imposant cadence et standards à des usines rarement sous les projecteurs.
Top 10 des pays leaders de la production textile : chiffres et spécificités
La Chine domine sans partage le marché mondial du textile, portée par des géants comme Shein, Shenzhou International ou Hengli Petrochemical. Juste derrière, l’Inde cultive sa puissance industrielle grâce à des filières enracinées et un marché domestique en plein essor.
Le Bangladesh et le Vietnam sont devenus incontournables pour les grandes enseignes mondiales, grâce à une main-d’œuvre nombreuse et à des infrastructures qui tournent à plein régime. De son côté, la Turquie tire profit de sa position géographique, entre Europe et Asie, pour offrir réactivité et savoir-faire. Les États-Unis restent un acteur industriel sur certains segments, comme le coton ou le denim, même si la consommation y dépasse de loin la production.
L’Europe mise sur la qualité et la spécialisation. L’Italie, l’Allemagne, l’Espagne et le Portugal défendent des créneaux haut de gamme ou techniques, soutenus par des groupes comme Inditex, H&M, LVMH ou Kering. La France se distingue avec des entreprises telles que Chargeurs SA ou Hermès, qui capitalisent sur l’innovation et le savoir-faire.
Voici les dix pays qui pèsent le plus dans la production textile mondiale :
- Chine
- Inde
- Bangladesh
- Vietnam
- Turquie
- États-Unis
- Italie
- Allemagne
- Espagne
- Portugal
La fast fashion tire la croissance, avec près de 60 % de la production totale. Les stratégies divergent selon les régions : production massive en Asie, montée en gamme en Europe, exportation intensive pour les pays émergents.
Les grandes entreprises qui façonnent l’industrie du vêtement à l’échelle mondiale
La géographie du textile mondial s’incarne à travers des groupes majeurs, répartis entre l’Asie, l’Europe et l’Amérique du Nord. En 2024, Toray Industries, entreprise japonaise, se distingue par sa maîtrise des textiles techniques et des fibres synthétiques. Présente sur tous les continents, elle investit dans l’innovation pour répondre aux défis de la mode et de l’environnement.
En Chine, Shenzhou International et Hengli Petrochemical assurent une production de masse. Shenzhou, spécialiste des vêtements en maille, fournit de grandes marques sportives et de prêt-à-porter. Hengli, avec ses fibres synthétiques, alimente la chaîne logistique mondiale. Leur force : l’intégration verticale, la réactivité et l’ampleur des volumes, qui dictent le tempo à l’ensemble du secteur.
En Europe, Inditex, la maison mère de Zara, Massimo Dutti, Bershka, et H&M incarnent la fast fashion. Leur modèle : renouveler les collections à toute allure, grâce à un réseau dense de sous-traitants en Asie, Europe de l’Est et Afrique du Nord. Shein bouscule les codes avec une stratégie numérique ultra-rapide et une production à la demande, réinventant le rapport à la mode.
Le segment du luxe, dominé par LVMH, Kering, Louis Vuitton ou Hermès, valorise la rareté, le savoir-faire et la maîtrise totale de la chaîne. En amont, des sociétés comme Chargeurs SA en France ou Sasa Polyester en Turquie fournissent les matières et textiles techniques qui nourrissent la diversité du secteur. La production mondiale de vêtements, c’est le résultat d’une poignée de groupes qui imposent leur cadence et façonnent les règles du jeu.
Fast fashion, enjeux sociaux et environnementaux : quelles conséquences pour la planète et les travailleurs ?
La fast fashion, symbole d’une mode jetable qui se renouvelle au fil des semaines, occupe près de 60 % de la production textile mondiale. Dans l’ombre des boutiques et des sites de vente en ligne, la réalité est brutale : jusqu’à 92 millions de tonnes de vêtements sont éliminées chaque année. Une infime part entre dans une boucle de recyclage ; l’immense majorité finit enfouie ou brûlée, alimentant une pollution chronique.
La production textile figure parmi les secteurs les plus polluants. Entre 8 et 10 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre lui sont attribuées. Les microfibres issues des textiles synthétiques envahissent les océans, perturbant la faune marine. La soif de coton et de polyester accentue la pression sur les ressources en eau et multiplie les pollutions chimiques.
La chaîne d’approvisionnement textile repose sur une sous-traitance éclatée, souvent opaque. En Chine, au Bangladesh, au Vietnam, en Inde, des millions de travailleurs du textile vivent avec des salaires faibles et des conditions précaires. Le drame du Rana Plaza au Bangladesh, en 2013, a révélé la fragilité de ces travailleurs, bien loin du confort des rayons occidentaux.
Des alternatives émergent peu à peu : certifications GOTS, Oeko-Tex, Ecolabel européen, lois françaises pour la durabilité, économie circulaire soutenue par la Fondation Ellen MacArthur. Le succès grandissant de la mode durable, de la seconde main ou de l’upcycling montre que les lignes bougent, même si la logique de surproduction reste difficile à inverser.
À l’heure où chaque t-shirt voyage plus que la plupart d’entre nous, le dilemme s’affiche sans fard : continuer sur la voie de la démesure ou rebattre les cartes d’une industrie devenue trop lourde pour la planète et pour ceux qui la font tourner.